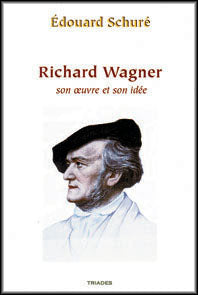Triades
Richard Wagner,son Oeuvre et son Idée- E Schuré
Richard Wagner,son Oeuvre et son Idée- E Schuré
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Édouard Schuré fit la connaissance de Richard Wagner en 1865 à Munich, après avoir assisté à la première de Tristan et Iseult. Il le revit en 1869 dans sa retraite de Lucerne, et en 1876, à l’inauguration du théâtre de Bayreuth, lors de la création de la Tétralogie. Il le connut ainsi à trois moments décisifs de sa vie : d’abord en pleine lutte avec son temps et l’opinion publique, ensuite dans le recueillement qui précéda la victoire, enfin au moment du triomphe définitif.
L’amitié et l’admiration de Schuré pour Wagner furent aussi entières que son indépendance vis-à-vis de lui. L’homme et l’œuvre sont éclairés ici avec une pleine spontanéité de sentiment et une absolue liberté d’esprit.
« Comme artiste, Wagner ressemblait à un puissant magicien capable d’évoquer toutes les passions par les incantations de sa musique et le ressort du drame. Comme penseur, il avait quelque chose du démon qui cherche à concevoir l’ange par la force de l’intellect et qui, malgré ses étonnantes facultés, souffre sous le poids de sa nature et aspire à la délivrance. Ce désir est le fil qui relie toutes ses œuvres. »
Sommaire
La jeunesse, les débuts, Rienzi
Le Vaisseau fantôme
Tannhäuser
Lohengrin
Révolution, exil et monde nouveau
Tristan et Iseult
Les Maîtres chanteurs
La Tétralogie
Parsifal
La place de Wagner dans l’histoire du théâtre
Le génie de la musique et l’avenir de l’art.
Extrait
Le lendemain et le surlendemain, je ne pus penser à autre chose. Les scènes enchanteresses du drame passaient nuit et jour devant mes yeux. La musique m’enveloppait toujours de sa magie. À travers le dédale de ces harmonies étranges, de ces mélodies incisives et charmeuses, je pénétrais toujours davantage dans les dessous des caractères et dans le secret de leur destinée. C’était une obsession, et loin de la fuir, je m’y abandonnais tout entier. Du matin au soir, j’errais dans le vaste parc qui s’étend derrière Munich, en relisant ce livret d’opéra qui était devenu pour moi le plus captivant des poèmes, attendant avec impatience le moment où le théâtre allait se rouvrir et me permettre de revoir Tristan et Iseult. Mais après la quatrième représentation, la série fut close. Le rêve était fini.
C’est alors que l’idée me vint d’écrire à Richard Wagner. Je le fis d’autant plus volontiers que la critique allemande l’avait abreuvé de sottises et de quolibets. Les caricatures du maître et de ses héros défrayaient les journaux de Munich. Dans le monde littéraire allemand, j’avais remarqué une totale inintelligence des œuvres de Wagner, une hostilité visible contre sa personne. Ses admirateurs ne formaient encore qu’un petit noyau. L’enthousiasme spontané d’un étranger pouvait-il compenser les flots d’encre et de bile que l’Allemagne déversait en ce moment sur le grand artiste dont elle devait être si fière plus tard ? C’était au moins un hommage dû à celui qui m’avait révélé un monde nouveau. Je ne sais plus au juste le contenu de cette lettre, je me rappelle seulement que j’y mis ces mots : « Votre œuvre m’a rappelé ce mot de Goethe que la musique exprime l’inexprimable. Vous avez réussi à faire ce qu’aucun poète ni aucun musicien n’a fait avant vous : vous avez montré la genèse de l’amour. »
Grande fut ma surprise et ma joie lorsque, peu de jours après, je reçus une lettre de Wagner, qui me priait de venir le voir. Me trouver en présence du grand compositeur me paraissait chose redoutable, et mon cœur battait quand je franchis les Propylées pour entrer dans la Briennerstrasse. Wagner habitait là une élégante villa à demi cachée dans un bouquet d’arbres et entourée d’un jardin. J’ouvris la grille, je sonnai à la porte, et un domestique mulâtre m’introduisit dans un petit salon aux tentures sombres, aux tapis luxueux, décoré de tableaux et de statuettes à peine visibles dans un demi-jour mystérieux. Au même instant, un rideau se souleva, et le maestro parut. Sa main nerveuse serra la mienne, et je me vis en face de l’auteur de Tristan et Iseult. Il paraissait fatigué et ne souriait que par une légère contracture des lèvres. Sa parole était précipitée, il s’exprimait par petites saccades. Après les compliments d’usage échangés, son premier mot fut celui-ci :
– Votre lettre m’a fait un plaisir extraordinaire. Je l’ai montrée au Roi, et je lui ai dit : Vous voyez que tout n’est pas perdu !
– Comment, m’écriai-je, tout serait-il perdu après la merveille de ces représentations ? Vous avez la presse contre vous, mais le public vous suit…
Il m’interrompit vivement :
– Ne croyez pas cela, il n’y comprend rien. Quand un Français s’enthousiasme, à la bonne heure, le voilà parti. Mais les Allemands, ce n’est pas la même chose. Quand par hasard ils sont émus, ils commencent par se demander si leur émotion est d’accord avec leur philosophie, et ils vont consulter la Logique de Hegel ou la Critique de la raison pure de Kant, à moins qu’ils n’écrivent dix volumes pour prouver qu’ils n’ont pas été émus et qu’ils ne pouvaient pas l’être. Ah ! ce public, cette presse, cette critique, voyez-vous, tout cela est du dernier misérable ; cela n’existe pas.
– Alors, vous n’êtes pas satisfait ?
– Satisfait ? (il se dressa comme un ressort, les yeux étincelants), satisfait ! oui, quand j’aurai mon théâtre, alors peut-être me comprendra-t-on. Pour le moment, je suis excédé, et vous me trouvez dans un formidable énervement.
Il se jeta sur le divan, la tête en arrière. Il paraissait vraiment souffrant ; une teinte jaunâtre, une expression de fatigue étaient répandues sur ses traits. Mais les lèvres frémissantes et la volubilité fiévreuse de la parole indiquaient cette énergie que rien ne lasse, cette volonté toujours prête à rebondir. La lumière de la fenêtre tombait en plein sur sa tête. Je pus enfin l’examiner en détail.
Wagner avait alors cinquante-deux ans. Impossible de voir une seule fois cette tête de magicien, évocateur et dompteur d’âmes, sans en garder une impression ineffaçable. Quelle vie d’âpres luttes et de sensations tumultueuses se lisait sur cette face tourmentée et creusée de traits énergiques, dans cette bouche rentrante aux fines lèvres à la fois sensuelles et sardoniques, dans ce menton pointu, signe d’une volonté indomptable ! Et sur ce masque d’une force démoniaque, ce front surplombant colossal de puissance et d’audace. Oui, ce visage ravagé portait la trace de passions et de souffrances capables d’user bien des vies d’homme. Mais on sentait aussi que l’immense cerveau qui travaillait sous ce front avait dominé cette vile matière de la vie pour la réduire en substance intellectuelle. Dans cet œil bleu, voilé de langueur ou fulgurant de désir, dans cet œil qui semblait toujours voir un but immuable, une vision constante dominait toutes les autres et lui prêtait comme une éternelle virginité ; – c’était la vision idéale, l’orgueil et le rêve divin du génie !
Observer la tête de Wagner, c’était voir tour à tour et dans un seul visage le front de Faust et le profil de Méphisto. Quelquefois aussi il ressemblait à un Lucifer tombé, méditant sur le ciel et disant : « Il n’existe pas, mais je saurai le créer. »
En somme, cet homme imposait moins encore par ses facultés prodigieuses et ses contrastes étonnants que par leur formidable concentration et cette merveilleuse unité de pensée et de volonté toujours dirigées sur un seul point.
Sa manière d’être ne surprenait pas moins que sa physionomie. Elle variait entre une réserve, une froideur absolue et une familiarité, un sans-gêne complet. Pas l’ombre de pose ou de mise en scène solennelle, jamais d’attitude voulue et calculée. Dès qu’il se montrait, il éclatait tout entier, comme un torrent qui rompt sa digue. Alors on restait ébloui devant cette nature exubérante et protéiforme, ardente, personnelle, excessive en tout et cependant merveilleusement équilibrée par la prédominance d’un intellect dévorant. La franchise et l’extrême hardiesse dans la manifestation de son être, dont les qualités et les défauts se montraient au grand jour, agissaient sur les uns comme un charme, sur les autres comme un repoussoir. Sa conversation était un spectacle continu, car, chez lui toute pensée devenait action. Sur ce vaste front, les idées et les sentiments se succédaient comme des éclairs et ne se ressemblaient pas. Il portait en lui ses grands héros. En quelques minutes, on pouvait retrouver dans l’expression de son visage la noire tristesse du Hollandais, le désir effréné du Tannhäuser, la fierté inabordable de Lohengrin, l’ironie glaciale de Hagen et la fureur d’Albéric. Oh ! l’étrange tourbillon que de regarder dans ce cerveau ! C’était, comme dit le poète, la buffera infernal che mai non resta. Et, dominant tous ces personnages qui se succédaient en lui, il y en avait deux qui se montraient presque toujours simultanément, comme les deux pôles de sa nature : Wotan et Siegfried ! Oui, par le fond de sa pensée, Wagner ressemblait à Wotan, à ce Jupiter germanique, à cet Odin scandinave qu’il a recréé à sa propre image, dieu bizarre, dieu philosophe et pessimiste, toujours inquiet de la fin du monde, toujours errant et méditant sur l’énigme des choses. Mais par sa nature primesautière, il ressemblait tout autant à Siegfried, le héros naïf et fort, sans peur et sans scrupule, qui se forge lui-même son épée et marche à la conquête de l’univers. Le miracle est qu’il réalisait ces deux types fondus en un seul par la constante union d’une réflexion profonde et d’une spontanéité jaillissante. Chez lui, l’excès de la pensée n’avait pas émoussé le ressort de la vie, et quels que fussent les soubresauts de celle-ci, il ne cessait jamais de philosopher. Il joignait un intellect calculateur et métaphysique à la joie et à l’éternelle jeunesse du tempérament créateur.
Sa gaieté débordait dans une écume joyeuse de fantaisies bouffonnes, de plaisanteries extravagantes, mais la moindre contradiction provoquait chez lui des colères inouïes. Alors, c’étaient des bonds de tigre, des rugissements de fauve. Il arpentait la chambre comme un lion en cage, sa voix devenait rauque et jetait les mots comme des cris, sa parole mordait au hasard. Il semblait alors un élément déchaîné de la nature, quelque chose comme un volcan en éruption. Avec cela des élans de sympathie fougueuse, des mouvements de pitié touchante, des tendresses excessives pour les hommes qu’il voyait souffrir, pour les bêtes et même pour les plantes. Ce violent ne pouvait voir un oiseau en cage ; une fleur coupée le faisait pâlir et, lorsqu’il trouvait dans la rue un chien malade, il le faisait porter chez lui. Tout en lui était gigantesque et démesuré. Son infatigable volonté fut d’autant plus forte qu’elle agissait instantanément par l’intermédiaire de sa puissante imagination. Ces deux pouvoirs réunis donnaient à Wagner un magnétisme presque irrésistible. Ce qu’il pensait, ce qu’il voulait se présentait à lui comme une vision intense. Cette vision, vraie ou fausse, bonne ou mauvaise, qui se créait dans son esprit, il la projetait dans les autres d’un mot, d’un geste ou d’un regard, avec une force égale à sa conviction. De là ce pouvoir de suggestion que subirent tant de personnes, cet empire presque illimité exercé sur tant de cœurs d’avance ensorcelés par sa musique.
Share